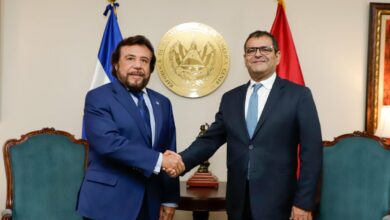Par Imane Alaoui
À quelques jours de la session du Conseil de sécurité des Nations unies prévue le 30 octobre 2025, toutes les attentions se tournent de nouveau vers le dossier du Sahara marocain, alors que se multiplient les signaux d’un soutien international croissant à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007 comme la seule solution réaliste et pragmatique susceptible de mettre fin à un conflit qui s’éternise depuis des décennies. Tandis que la diplomatie marocaine avance avec assurance, l’Algérie et le Front Polisario se retrouvent de plus en plus isolés, incapables de convaincre la communauté internationale de relancer l’option, désormais obsolète, du référendum.
Des informations diplomatiques émanant des coulisses du Conseil de sécurité indiquent que les États-Unis, la France et la majorité des membres permanents s’orientent vers l’adoption d’une nouvelle résolution consacrant la logique d’une solution politique réaliste fondée sur l’autonomie, tout en réaffirmant le rôle central du Maroc dans ce processus. Cette orientation provoque un désarroi évident dans le camp algéro-polisarien : le Polisario y voit une “dérive de la légalité internationale”, tandis que l’Algérie dénonce une “pression politique au service de l’agenda marocain”. Mais cette posture défensive peine à masquer une réalité : la communauté internationale se détourne des slogans idéologiques pour privilégier désormais la stabilité régionale et le développement partagé.
Les évolutions rapides des positions européennes renforcent cette tendance. L’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, ainsi qu’un nombre croissant de pays africains et asiatiques, reconnaissent l’initiative marocaine comme la référence la plus sérieuse et crédible. L’Union européenne elle-même continue de coopérer économiquement et commercialement avec les provinces du Sud du Royaume, reconnaissant de facto la souveraineté marocaine sur ces territoires à travers les accords de pêche, d’agriculture et d’échanges couvrant les produits du Sahara marocain. Une évolution qui représente un revers cinglant pour la propagande algérienne, laquelle s’obstinait à présenter ces territoires comme “disputés”. Désormais, les institutions européennes parlent sans détour des “régions méridionales du Maroc”.
Face à cette dynamique, l’Algérie persiste à dilapider ses ressources en soutenant politiquement et médiatiquement le Polisario, malgré une crise économique et sociale profonde. Le régime algérien, confronté à une contestation interne croissante, utilise le dossier du Sahara pour exporter ses tensions internes et détourner l’opinion publique nationale. Mais cette stratégie se retourne contre lui : Alger perd du terrain en Afrique, où une majorité d’États soutiennent désormais l’intégrité territoriale du Maroc, soit par l’ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla, soit par un appui diplomatique clair au sein de l’Union africaine.
Dans le même temps, le Polisario subit un affaiblissement politique et militaire manifeste. Incapable de mobiliser l’opinion internationale, le mouvement apparaît de plus en plus comme un obstacle au développement régional. Ses récentes provocations près du mur de défense marocain n’ont suscité que condamnation et mise en garde de la part des Nations unies et de plusieurs grandes capitales, qui ont averti contre toute tentative de déstabilisation d’une zone stratégique reliant l’Afrique à l’Europe.
Dans ce contexte, la session du Conseil de sécurité de fin octobre s’annonce décisive. Le Conseil devrait réaffirmer la nécessité de relancer le processus politique sous l’égide de l’envoyé spécial Staffan de Mistura, mais dans une perspective plus pragmatique, excluant toute solution fondée sur la séparation ou un référendum inapplicable. Le monde reconnaît désormais que le Maroc est un pilier de stabilité en Afrique du Nord, un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme et les migrations illégales. Pour beaucoup de pays, soutenir l’initiative marocaine, c’est soutenir la sécurité régionale et les intérêts économiques partagés.
Quant à l’Algérie, qui espérait rallier ses alliés au sein du Conseil, elle se retrouve dans une posture de faiblesse inédite. Les rapports internationaux évoquent une marginalisation diplomatique évidente et une érosion de sa crédibilité, son discours étant désormais perçu comme un frein à la paix. À l’inverse, le Maroc consolide sa position par une diplomatie à la fois ferme et souple, appuyée sur des alliances solides avec les grandes puissances et sur des partenariats économiques réussis avec l’Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays africains émergents.
Quelle que soit la formulation finale de la résolution onusienne attendue à la fin du mois, le Maroc aborde cette nouvelle bataille diplomatique avec assurance et légitimité, tandis que l’Algérie et le Polisario font face à une réalité internationale qu’ils ne peuvent plus nier. Le conflit qu’Alger a tenté d’exploiter pendant un demi-siècle comme levier de pression régionale s’est transformé en fardeau diplomatique et politique, au moment où Rabat avance résolument vers la consolidation de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, soutenue par un appui international croissant et une vision stratégique claire faisant de l’autonomie le cadre définitif d’une solution juste, réaliste et durable, garante de la dignité de tous et de la stabilité du Maghreb.