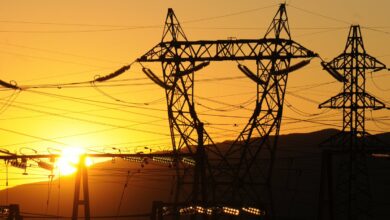Par Iman Alaoui
Depuis l’éclatement de la guerre russo-ukrainienne en 2022, le régime algérien s’est trouvé dans une posture ambiguë, oscillant entre neutralité affichée et calculs opportunistes. Officiellement, Alger proclame son “non-alignement” et son “attachement à la paix”, mais en réalité, elle a opté pour une stratégie pragmatique, parfois proche de la duplicité, envers Moscou — son allié historique depuis des décennies. L’Algérie, qui a bâti sa puissance militaire et son équilibre géopolitique sur le soutien russe, a rapidement réorienté sa boussole dès qu’elle a perçu l’occasion d’accéder au marché européen comme alternative potentielle au gaz russe. Une nouvelle phase de manœuvres et d’alignement déguisé contre la Russie s’est alors ouverte.
En façade, le discours officiel algérien continue d’évoquer une “amitié historique” et une “coopération stratégique solide” avec Moscou. Mais derrière les coulisses, les signaux envoyés vont dans la direction opposée. Dès la première année du conflit, la diplomatie algérienne s’est discrètement rapprochée de Kyiv par des canaux européens. Des sources diplomatiques crédibles évoquent des contacts indirects, menés sous couvert de “médiation”, mais dont l’objectif réel était d’évaluer les opportunités d’un repositionnement en cas d’affaiblissement durable de la Russie sur la scène internationale.
Ce glissement s’est accentué à travers l’ouverture de canaux informels avec des responsables ukrainiens via Berlin et Paris. Alger aurait même pris part à des réunions confidentielles consacrées à la redéfinition de la carte énergétique post-guerre, proposant d’augmenter ses livraisons de gaz afin de compenser le déficit européen provoqué par les sanctions contre Moscou. En d’autres termes, l’Algérie est passée du statut d’allié dépendant à celui de concurrent direct, exploitant la fragilité russe pour renforcer ses liens avec l’Europe. Une démarche que le pouvoir présente comme la défense des “intérêts nationaux”, mais qui s’apparente en réalité à un revirement diplomatique et à une rupture tacite avec la loyauté historique envers la Russie.
Des analyses publiées dans Modern Diplomacy, The Washington Institute et ISPI Italy confirment d’ailleurs le malaise croissant de Moscou face à cette attitude. Alors que la Russie comptait sur un soutien algérien au sein des Nations unies, Alger a préféré s’abstenir ou briller par son absence lors des votes condamnant l’invasion de l’Ukraine. Ce comportement a été interprété par le Kremlin comme un signe de désengagement. Plus troublant encore : certains rapports de renseignement européens évoquent un appui technique limité fourni par Alger à Kyiv — notamment dans le domaine énergétique — via des intermédiaires européens, en échange d’avantages économiques. Un véritable coup de poignard pour un partenaire militaire et économique de longue date.
Ce repositionnement s’explique aussi par la volonté du régime algérien de redorer son image en Europe après des années de crispation. La guerre en Ukraine a offert à Alger une occasion inespérée de redevenir un acteur “fréquentable” aux yeux des Européens en quête désespérée de nouvelles sources d’énergie. Le pouvoir algérien a ainsi cherché à se présenter comme le “remplaçant sûr” du gaz russe — un calcul stratégique au moment même où Moscou avait besoin de ses alliés plus que jamais.
Mais ce que le régime présente comme une “diplomatie intelligente” n’est en réalité qu’un jeu à double face révélant la capacité du pouvoir à renier ses alliances dès que ses intérêts immédiats l’exigent. De partenaire militaire fidèle, l’Algérie s’est muée en concurrent énergétique et en interlocuteur discret de Kyiv. Elle avance sur un fil ténu entre Moscou et Bruxelles, démontrant que sa politique étrangère repose davantage sur la manœuvre et la transaction que sur des principes constants.
Aujourd’hui, la méfiance s’est installée. Moscou regarde Alger avec suspicion, tandis que l’Europe reste prudente, consciente de la versatilité du régime. L’Algérie, elle, continue de jongler entre les deux pôles, misant sur la rivalité russo-occidentale pour maximiser ses gains. Mais cette stratégie de “jeu sur les deux tableaux” risque de lui coûter cher : en cherchant à tout gagner, elle pourrait bien finir par tout perdre — la confiance de Moscou comme celle de l’Europe.