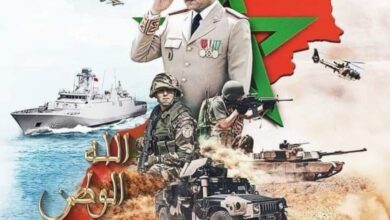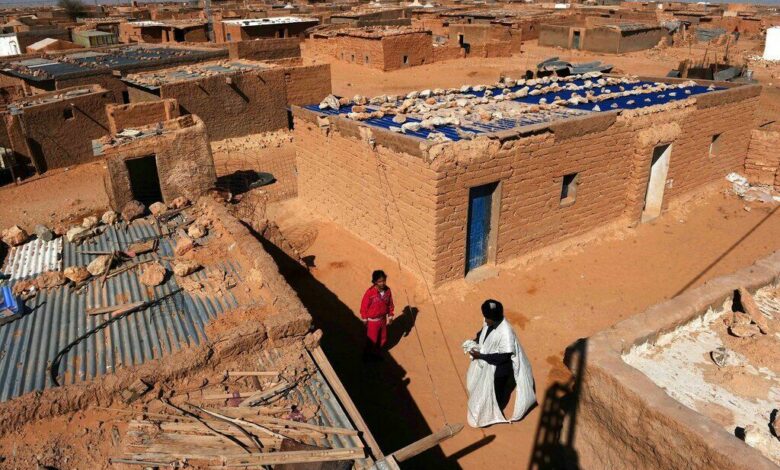
Par Zakaria El Jabri
Au cœur du désert de la Hamada algérienne, là où s’étendent les camps fermés de Tindouf, se cache l’une des plus grandes manipulations politiques d’Afrique du Nord : le mythe des « réfugiés sahraouis ». Derrière la façade humanitaire que brandissent le régime militaire algérien et la soi-disant « Front Polisario », se dissimule une réalité démographique dérangeante, qui contredit la version officielle utilisée depuis des décennies pour entretenir l’hostilité envers le Maroc et prolonger un conflit artificiel autour du Sahara marocain.
En réalité, la majorité des habitants de ces camps n’ont aucun lien, ni géographique ni historique, avec les provinces du Sud marocain. Seule une minorité provient effectivement des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab. La grande majorité des résidents sont issus d’un mélange de populations locales de Tindouf (les Sahraouis de la Hamada), de Mauritaniens et de Touaregs de l’Azawad venus du nord du Mali. Cette mosaïque humaine a été délibérément rassemblée au fil des décennies afin de gonfler artificiellement le nombre de « réfugiés » et de soutenir la rhétorique politique de l’Algérie devant les Nations unies.
L’un des paradoxes les plus frappants réside dans le fait que ces « Sahraouis de Tindouf » vivent sur leur propre sol, en territoire algérien, sans bénéficier de la citoyenneté du pays. Le même régime leur refuse ce droit, alors qu’il l’a accordé à d’autres dès 1962. Comment le pouvoir militaire algérien peut-il exiger un « droit à l’autodétermination » sur un territoire marocain tout en refusant ce même droit à ses propres citoyens ? Ne serait-il pas plus cohérent d’appliquer ce principe sur son propre territoire avant de le prêcher ailleurs ?
L’histoire, elle, ne ment pas. Les terres de Tindouf faisaient historiquement partie du territoire marocain jusqu’au milieu des années 1950, avant que la France coloniale ne les rattache à l’Algérie. Cette vérité historique place le régime algérien dans une impasse existentielle : il se retrouve coupable d’une falsification à la fois géographique et démographique.
Quant au reste des habitants des camps – Mauritaniens et Azawadiens – ils n’ont aucun rapport avec le Sahara marocain et ne peuvent en aucun cas être considérés comme partie prenante d’un différend territorial entre le Maroc et son voisin de l’Est. Leur présence à Tindouf n’est qu’un instrument de chantage international, un moyen d’obtenir une aide humanitaire détournée au profit des généraux algériens et des dirigeants du Polisario.
C’est d’ailleurs ce qui explique l’obstination maladive du régime algérien à refuser tout recensement officiel des habitants des camps. Un simple recensement suffirait à mettre à nu le mensonge, à révéler le nombre réel de ces « faux réfugiés » utilisés comme levier politique dans un conflit sans légitimité.
Les estimations réalistes indiquent que ceux ayant effectivement des liens familiaux ou historiques avec le Sahara marocain ne dépassent pas vingt mille personnes, pour la plupart issues de la tribu des Lbouhitt, un rameau des célèbres Rguibat. La majorité restante n’est qu’un ensemble de victimes d’une manipulation politique et idéologique de plus d’un demi-siècle, prisonnières des murs des camps et d’un mirage d’« État à venir ».
Depuis les années 1990, la majorité des véritables Sahraouis ont regagné leur patrie, le Maroc, où ils ont trouvé stabilité, développement et dignité. L’Algérie, elle, continue de se servir des autres comme de simples pions diplomatiques, sous couvert d’un discours humanitaire qui masque mal des ambitions régionales bien connues.
Aujourd’hui, l’heure de vérité approche. Le monde réalise peu à peu que la « question du Sahara » n’a jamais été qu’une carte jouée par un régime en crise, cherchant à dissimuler ses échecs internes et ses luttes de pouvoir. Le théâtre de Tindouf s’apprête à baisser le rideau : le régime algérien ne pourra plus renouveler sa « licence de trafic humain », maintenant que la supercherie est exposée et que le masque du « libérateur » est tombé, révélant la réalité d’un système fondé sur l’exploitation et la rétention.