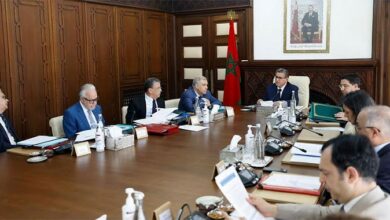Par: / Imane Alaoui
Le vote de l’Algérie en faveur du projet de résolution américain concernant Gaza au Conseil de sécurité a retenti comme une gifle politique. Une gifle non seulement pour sa diplomatie, mais aussi pour un discours officiel construit depuis des décennies sur des slogans, des mythes et un anti-impérialisme proclamé. Ce moment n’a rien eu d’un simple geste diplomatique. Il a marqué une rupture, la fin d’un récit longtemps instrumentalisé autour de causes justes – au premier rang desquelles la Palestine – utilisées comme vitrines politiques et comme distraction pour un peuple confronté à un malaise économique et institutionnel profond.
Le choc a été d’autant plus fort que l’opinion publique algérienne a grandi avec une narration uniforme : l’Algérie serait éternellement du côté des opprimés, en opposition frontale avec l’Occident, porteuse de valeurs révolutionnaires et anti-impérialistes. Or, la réalité est désormais mise à nu : le régime militaire algérien a voté là où l’exigeaient les intérêts diplomatiques et les pressions de Washington — non pas là où dictent les slogans ni là où l’attendait son peuple. En un instant, le lexique héroïque répété par les médias d’État s’est effondré, laissant apparaître ce qu’il était réellement : une façade, un décor fragile face aux logiques de puissance.
Pour les observateurs attentifs de la politique algérienne, cette volte-face n’a rien d’une surprise. Depuis l’indépendance, le pouvoir militaire n’a jamais misé sur la construction d’une économie forte, ni sur une diplomatie stratégique durable. Son influence reposait plutôt sur la rhétorique émotionnelle, la glorification du passé et la sacralisation de combats externes, tandis qu’en interne, il réprimait l’opposition, bâillonnait la presse et verrouillait la vie politique sous la tutelle des généraux. Lorsqu’un véritable test international se présente, la différence devient flagrante entre les nations qui construisent leur souveraineté et celles qui se contentent de la clamer.
Le véritable débat n’est donc plus de comprendre pourquoi l’Algérie a voté ainsi, mais ce que ce vote révèle. Le régime a-t-il réellement incarné ce rôle de “voix des peuples” et de défenseur de la Palestine, ou cette cause n’a-t-elle été qu’un prétexte pour légitimer un pouvoir fragilisé, figé dans une révolution muséifiée plutôt qu’incarnée ? Comment un État prétend-il défendre la cause palestinienne tout en s’alignant diplomatiquement derrière la principale puissance alliée d’Israël ?
Pour beaucoup d’Algériens, la stupeur s’est rapidement transformée en colère. Le public, mieux informé, plus connecté, n’accepte plus les discours formatés ni les justifications tardives diffusées par des médias alignés sur les instructions du pouvoir. La société algérienne change : elle compare, analyse, questionne. Et surtout, elle ose ce qui était impensable il y a encore quelques années : demander des comptes à une autorité qui gouverne au nom de la révolution, plus qu’au nom d’un contrat démocratique.
Ce qui s’est joué au Conseil de sécurité dépasse de loin la portée d’un seul vote. C’est un tournant. Une démonstration que la rhétorique portée par le régime n’est pas un projet politique mais un outil de survie. Une preuve que lorsqu’il s’agit de garantir sa longévité, le pouvoir militaire algérien est prêt à tourner le dos aux symboles qu’il prétend sacraliser.
S’il y a une leçon à retenir, c’est bien celle-ci : les peuples ne restent pas indéfiniment prisonniers du récit officiel. Les régimes qui s’appuient sur la surenchère idéologique plutôt que sur la légitimité réelle finissent tôt ou tard par être confrontés à leur propre contradiction. Il suffit d’un événement — une voix levée là où elle ne devrait jamais l’être — pour que la façade se fissure et que la réalité, enfin, apparaisse.