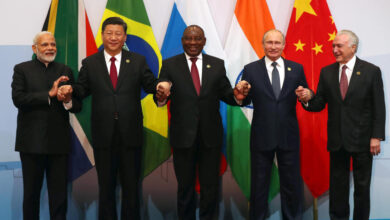Par Meryem Hafiani/ ALDAR
Lorsqu’on observe la scène marocaine aujourd’hui et qu’on la compare aux secousses traversées par les grandes démocraties occidentales, le contraste est frappant. Ce qui se déroule au Maroc n’atteint même pas le dixième de ce que la France a connu en 2018 avec le mouvement des « gilets jaunes ». Parti d’une contestation contre la hausse du prix du carburant, ce mouvement s’est vite transformé en tourbillon politique et sécuritaire qui a ébranlé Paris et de nombreuses autres villes. Le bilan fut lourd : morts, blessés, milliers d’arrestations. Les autorités françaises ont mobilisé blindés et armée, imposant de strictes restrictions aux manifestations. Pourtant, le système institutionnel n’a pas vacillé : Emmanuel Macron a été réélu, preuve que fermeté et légitimité démocratique ne s’excluent pas.
La France n’est pas une exception. Les États-Unis, berceau de la démocratie moderne, ont connu récemment de vastes mouvements de contestation marqués par des scènes de violence, de pillages et d’incendies. Les émeutes liées au mouvement « Black Lives Matter », après la mort de George Floyd, ont même conduit au déploiement massif de la Garde nationale dans plusieurs États. En Espagne, les velléités indépendantistes catalanes en 2017 furent réprimées par la force et par une vague d’arrestations, sans que cela soit assimilé à une quelconque atteinte systématique aux droits fondamentaux. La règle est claire : aucun État n’accepte que ses rues deviennent un terrain de chaos incontrôlé.
Face à cela, la situation au Maroc apparaît sous un tout autre jour. Ce que vit aujourd’hui le royaume reste limité et souvent amplifié artificiellement par ses adversaires, qui s’emploient à transformer la moindre mobilisation en menace existentielle. Mais la réalité est tout autre : fort de son expérience historique et de la solidité de ses institutions sécuritaires, le Maroc demeure une exception dans une région en proie aux secousses et à l’instabilité. Alors que nombre de ses voisins ont sombré dans la violence ou le désordre, il a choisi la voie de la continuité, s’appuyant sur ce qui constitue sans doute sa plus précieuse ressource : la stabilité.
Cette stabilité n’est pas le fruit du hasard. Elle découle d’une conscience collective : le désordre ne profite qu’aux ennemis et aux opportunistes, tandis que la préservation de la nation passe avant toute chose. Les revendications sociales et économiques existent, et elles sont légitimes. Mais il y a une différence fondamentale entre protestation responsable et vandalisme désordonné : l’une relève de la construction, l’autre de la destruction. Et les Marocains savent pertinemment que leur pays ne peut se permettre d’être le champ d’expérimentation des rancunes extérieures.
À plusieurs reprises, certains ont tenté de semer la discorde à travers les réseaux sociaux, ou d’exploiter des incidents isolés pour affaiblir le Maroc. Chaque fois, ces entreprises ont échoué face à la vigilance des institutions et à la lucidité des citoyens. Le résultat est là : le royaume continue de représenter un modèle de stabilité dans un environnement régional et international marqué par les turbulences.
En définitive, si le Maroc constitue une exception, ce n’est pas parce qu’il est épargné par toute contestation, mais parce qu’il a su préserver l’équilibre entre liberté et ordre, entre droit d’expression et devoir de protection de la patrie. Là où d’autres pays s’effondrent sous le poids du désordre, le Maroc demeure debout, digne, conscient que la sécurité est une richesse inestimable.